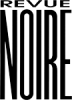Tchicaya U Tam’si, né en 1930 à M’Pili (Congo),décédé en France en1988. Poète, romancier dramaturge, il est l’un des plus plus grands auteurs africains francophones.
Poésies : Le mauvais sang (1955), Feu de brousse, À triche cœur (Ed.P.J. Oswald), Le ventre (1964), Le pain ou la cendre (1978, Ed. Présence Africaine)·
Théâtre : Le destin glorieux du dernier Maréchal Nnikon Nniku, prince qu’on sort (1979, Éd. Présence Africain), Le bal de Ndinga (1987).
Romans : Les cancrelats (1980), Les méduses ou les orties de mer (1982), Les Phalènes (1984, Ed. Albin Michel), Ces fruits si doux de l'arbre à pain (1987, Ed. Seghers).
***
La source
[publié dans RN 05 en juin 1992, texte inédit original en français.]
Ce texte peut être lu comme un échange d'idées avec son compatriote Sony Labou Tansi et sa 'Lettre infernale à Monsieur Arthur Rimbaud' publié dans RN 08 en décembre 1992.
”Je préfère courir au vent de l'histoire ou me saouler de vin,
c'est une revanche à prendre sur l'agonie qui viendra toujours trop tôt .
Trêve de fatalisme .»
Ces quelques lignes prémonitoires accompagnaient les vœux de bonne année
et le texte ’La Source’ que Tchicaya m'adressait au début de l'année 1988, quelque temps avant sa mort.
Il ajoutait qu’il se voulait iconoclaste devant la foi de tous les admirateurs du Dieu Source.
Revue Noire se trouve être le lieu à privilégier pour un partage de cette parole libre.
Nicole de Pontcharra
La source, l’identité : les deux faces d’une porte du même coté.
Il est, en effet, admis que l’identité tire sa légitimité de la source. La source nourrit l’identité. Lui donne créance, l’authentifie, l’estampille d’un lustre et d’une patine qui font sa marque. Ainsi donc, dit-on, par exemple, telle source, tel fleuve. Et pourtant aucun fleuve ne remonte à la source, il conflue toujours plus loin, où il est majestueux, peu reconnaissable de ceux qui l’ont vu à la source. La proposition telle source, tel fleuve ne joue pas entièrement. Les climats traversés sont autrement plus déterminants. Ils corrigent, infléchissent. La géologie et les terres de rencontre sont décisives. Bref, la source ne reconnaît pas le fleuve. Le fleuve ne renie pas la source, mais leur lien de parenté est oblitéré par un profond sevrage. Lequel, en promulguant la rupture, installe non pas une frontière, mais deux démarches, c’est-à-dire deux destins, dans la plus parfaite indépendance, l’un de l’autre. Le fleuve a un autre destin que la source. Ils n’ont pas une identité de destin. Ils n’ont donc pas une même identité.
L’origine modeste de la source ne peut donc être mise en parallèle avec la munificence du fleuve qui a pris tant d’eau venue d’ailleurs. D’autres sources peut-être. Nil bleu, nil rouge. Aux deux versants d’un même bassin, certes. La source n’a qu’un paysage, le fleuve en mille à revendre, d’amont en aval, jusqu’à la mer qui le gobe.
Il en est de la source comme de l’identité. L’identité d’un individu n’est pas de donnée. Elle aussi instable, imprévisible que le cours du fleuve naissant en quête de profil d’équilibre. Elle n’est pas donnée parce qu’elle est dynamique. Oui, il en va de la source comme de l’identité. Contentons-nous de la définition de l’homme qu’on offre à Diogène : Un animal à deux pattes. Qui lui servent à se mouvoir, passé le temps du sevrage, encore une fois. Voit-p, cet animal retourner dans le ventre de sa mère ?
Point. Mère et fils deux destins, dont les liens sont affectifs donc subjectifs. Il n’est pas avéré qu’ils soient d’une autre nature, parce que, en réalité, ces liens ne sont exclusivement que d’un ordre moral. Du temps d’Abel, Eve est une femme qu’il partage avec Adam. L’idée de mère, épouse exclusive du père, est noble, certes, mais combien dangereusement névrotique. Malheur au fils qui n’a pas désiré sa mère, s’il ne s’est condamné à l’hypocrisie de ne la désirer vainement que dans le corps des autres filles d’Eve. Le tragique du complexe d’Œdipe ne naît que de cette aberration.
Et encore, où prend-on racine ? Je ne ris de ceux qui se targuent d’en avoir, qu’ils sont incapables d’exhiber. Elles sont trop fictives, aussi en lancent-ils dans les savantes hyperboles pour en parler, mais pas pour les rendre tangibles au sourd-muet. Vanité de toute généalogie !
L’hérédité se cultive. L’atavisme est un réflexe animal en nous. Mais l’animalité c’est ce que la société s’acharne le plus à détruire. Toute éducation veut remodeler et tend à reproduire une contre-façon d’être. La docilité prévient la révolte contre les dogmes. L’hérédité et l’atavisme ensemble ne peuvent, à eux seuls, fonder l’originalité d’un destin. Il est à peine concevable que deux frères, dont la consanguinité est avérée, puissent avoir une silhouette et une démarche juxtaposables. A confondre dans un même destin.
Identité, source, racines s’écrivent en lettres d’or au grand pavois qu’on agite pour égarer les peuples, les distraire de la nécessité de gagner le manger, le boire, le dormir décent. Les bercer d’illusions néfastes afin qu’ils fassent, le moment venu; lit de leur vie. Les racines dont on parle tant ne garantissent personne contre la rage de dents et d’autres maux, ni de la faim dans le pire des cas. Les fruits de l’arbre sont plus importants que les racines, lui au moins, ses racines ne sont une abstraction orgueilleuse.
Me voici loin de ma source
parmi les planctons
que mangent les poissons
issus d’abysses qui ne sont du climat
tropical englué d’herbes et d’arbres
quand la minute où je nais
s’en est allée mourir avec le temps passé
me faut-il survivre à son agonie
Je batifolerai à dos de cachalot
divin
Loin aussi de mes “ racines “. À moi la vie autour du globe, en attendant la transhumance vers d’autres galaxies. La paix dans le bonheur d’être libre de toute entrave, de toute fidélité à de putrides agonies. Je me mets le feu à mes plaies. Les douleurs de coeur me trouveront désormais impavide. Si j’ai un mot d’ordre à donner à ceux qu’on enchaîne au terroir, c’est : Bougez !! Circuler ! Jetez les tabous ! Vivez la vie vive, en expansion ! Chiez plutôt sur la terre qui vous a vu naître, ça ne la fertilisera que mieux.
J’en reviens à l’eau douce de la source. Elle est plus cristalline du chant que celle que le fleuve charrie à la mer ou encore que celle du fleuve qui ne charrie à la mer. J’avais pied et voilà que, maintenant, il ne faut faire mieux que léviter, affronter les ressacs, être drossé à vif des deux flancs par l’épouvantable vague hauturière. Je sais l’aventure hasardeuse et humaine donc, mais il ne fallait pas que la source s’écoule. Qu’elle stagne glauque, afin de n’être qu’elle, figée là. Source-génie-lare, sans appétit du large. N’étant habitée d’aucun rêve d’évasion. Ni torturée par aucun de ces cauchemars qui font que, de sauter loin du lit, donne, un éclair, accès à la lumière de l’éveil et du matin. Bercer quelques cailloutis, c’est croupir. Je prends donc le parti du voyage. Je n’ai plus les pieds sur terre ? Qu’importe. Je suis ivre d’avoir le dos à fleur de courants marins qui tourbillonnent. À moi aussi toutes les aubes, si je triomphe de la précarité de l’aventure humaine.
D’aussi loin que je me souvienne j’ai couleur de boue. Ocre ou fangeuse. Verte aussi de la forte putridité de tous les végétaux que ma digestion gloutonne relâche, pris de coliques cérébrales. Ah! Je sais bien que l’orgueil que l’on a de la source est passéiste. Je scintille à l’espoir d’une prise de sels régénérateurs. La mer me le promet. Le bain de mer pourvoira. Non, je n’irai pas à la source à contre courant du fleuve qui me mène à la mer.
Oui, décidément avoir les pieds dans l’eau de la source jusqu’aux chevilles, m’interdirait toujours d’aller au-delà de l’aventure humaine. Je ne m’y ferai pas. Autant vite tarir la source et courir à jet de galet, jusqu’à la perte de toute mémoire des eaux glaireuses du placenta.
Je suis un voleur de feu
parce que je suis soufre
et phosphore des chairs
et de l’âme aigue-marine
Les voleurs de feux ne restaient jamais en place. Bivouac après bivouac, ils inondaient les braises désormais inutiles sous les eaux sales de leur ablutions, et s’en allaient ne redoutant même pas les tempêtes de sable, dans les déserts, se souciant seulement de préserver la lumière en eux, misant sur la Croix du Sud, afin que la mort ne prenne double hypothèque sur leur salut. Tout danger surmonté est une leçon magistrale, c’est en plus une expérience acquise. Demandez donc à ce voleur de feu de psalmodier pour vous le parcours des astres, vous en conviendrez que leur mémoire est celle des temps à venir et non celle du temps passé par Job à croupir sur un tas de fumier. La vie à vivre est une conquête et non une réminiscence. Sus au feu du ciel ! Sus au soleil ! Toute est lumière est plus digeste que les basaltes ou les grès des pierres tombales. Je fais fi aussi des antécédents de quelques natures qu’ils soient. Excepté du feu, c’est d’ailleurs rare qu’ils en soient.
J’ai été souillé par trop de choses vues, vécues, pour prévaloir de la lustralité d’une source dont le souvenir que j’ai n’est pas celui d’une fontaine de jouvence, mais d’un lieu trop étroit pour y passer la tête que j’ai grosse et bosselée de coups durs. Les vicissitudes n’ont trop marqué de petite vérole ou d’autres calamités, pour que je ne reconnaisse dans l’image de moi qu’aurait gardée la source, qu’elle me montrerait, à supposer qu’y remontant, j’y arrive en plein jour, par temps clair et ensoleillé, ou, par clair de lune de pleine lune. Un temps empuanti de lichens douçâtres.
Bref, je ne crois pas plus aux racines qu’aux sources. Les amarres larguées depuis je ne sais combien de solstices. Je tournerai toujours le dos à l’endroit d’où je viens. Ayant le cou fragile, je ne me retourne jamais, pour jeter un regard nostalgique en arrière. En toutes circonstances. Parce que chaque crise de nostalgie qui m’assaille, me navre le coeur, me noie les deux poumons. Je cours à l’air du large la narine gloutonne, humer le bouquet d’algues et d’iode. C’est comme ça, peut-être que la source qui m’a fait surgir de terre, à l’approche d’une nuit, m’a ainsi conçu. A la diable, je le reconnais.
Et si la mer était la vrai source
les fleuves pour n’avoir pas de sel
les fleuves se salissent de la boue
que les pieds des vandales ont mêlée
au sang des martyrs de leur pillage.
Les sources dont je me méfie le plus sont celles qui ont été défigurées par l’histoire sanglante des hégémonie vicieuses. Ainsi, les fontaines votives consacrées au culte d’ancêtres dont l’idiotie serait divinisable, par exemple.
Le placenta, première place d’armes jeté
Le cordon ombilical, lien premier jeté
A quel abus de fidélité m’abonner
Je préfère sur dos de cachalot
jouer le drame du naufrage
à perpétuité.
C’est prescrit au rituel de la naissance. On a rompu aux deux extrêmes le cordon ombilical ; on a noué le nombril. Une cicatrice témoigne de cette rupture sauvage. Si mon ventre la porte encore – comme un stigmate, une flétrisseuse – c’est une raison de plus de ne pas donner à ce rituel si barbare une valeur propitiatoire. Expulsé du ventre, jeté en pâture du monde, je chercherai toujours la lumière derrière laquelle me cacher, pour échapper au vieux démons, aux vieux instincts. Grégaires ou autres.
Je soutiens que l’idée de source est mythifiante. Une dangereuse mystique. D’elle, hélas, sont issues de légions de prophètes les plus prompts à promettre l’apocalypse si l’on ne marche pas vers les ténèbres de la soumission à leurs dogmes. M’y soumettrai-je ? Jamais ! Dussè-je vendre mon âme au Diable. Les lumières les plus intimes nous viennent de sources qui ne sont plus. J’ambitionne donc d’être la lumière errante d’une source morte. De profundis, donc. Clamavi ! L’aventure, plutôt que les pieds liés de certitudes obsolètes.
À bas tout ce qui peut nourrir le fanatisme imbécile !
Toute idée reçu est névrotique. Qu’importe d’où vient le vent et le vin.
Tchicaya U Tam’si
***