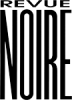Vincent Placoly (1946-1992) étudie au lycée Louis-Le-Grand à Paris, avant de rentrer en Martinique. Écrivain et militant politique de Martinique, il fonde ses convictions sur la Négritude et de la Créolité. Il défendit l’ancrage américain de la Martinique et des Caraïbes.
Oeuvres : ‘La vie et la mort de Marcel Gonstran’ Éd. Denoël 1971, Réédition aux Éd. Passage(s) 2016 ; ’L’eau-de-mort guildive’ Denoël 1973 ; ’Dessalines ou la passion de l’indépendance’, La Havane, Ediciones casa de las Americas 1983 ; ’Frères volcans : chronique de l’abolition de l’esclavage’ Éd. la Brèche 1983 ; ’Don Juan : comédie en 3 actes’ Éd. Hatier-Antilles-Agence de coopération culturelle et technique 1984 ; ’Dessalines, Case-Pilote, l’Autre mer’ 1994 ; ’Une journée torride’ Éd. La Brêche 1991 (Prix Frantz Fanon)
***
À cinq heures pile comme tous les jours…
[texte inédit publié dans RN06 Caraïbes en septembre 1992, texte original en français]
À cinq heures pile comme tous les jours, le dénommé Jesu-Christiu s’assit sur son séant, fouilla machinalement la poche kangourou de la parka qui lui servait de pyjama, en extrayit un joint qu’il alluma et se mit à fumer tout en rêvant… Dehors, il faisait un temps gris, maussade et de mauvais augure. Les gens se déplaçaient pauvrement vêtus, pour ne pas dire qu’ils étaient en guenilles. Pourtant, Jesu-Christiu, en mâchonnant son kif, ne cessait de penser qu’il n’y avait rien de plus beau que la création du monde, celle-ci ayant été accomplie de main de maître. Il n’avait pas volé son surnom de rêveur. Montrez-lui une poubelle, il y voyait la table mise des pauvres. Un canard cendré, affaibli, épuisé par la pollution atmosphérique ambiante venait-il à s’affaisser dans le caniveau, qu’il le recueillait, le soignait, le gavait de pain rassis mouillé dans du pâté pour chiens, et il le remettait à voler, plus vif et gaillard que si la pauvre bête était tombée du nid maternel. A la longue, il se faisait un public, une réputation. De là à ce qu’on lui demande de guérir les aveugles et les paralytiques…
Ayant fini son joint, il se leva de son grabat, resta un instant les jambes fléchies, les mains sur les genoux, et péta, longuement, avec application, pour que tout le vent qui encombrait ses boyaux s’en extirpât jusqu’à la dernière bulle. C’était ce qu’il appelait son hygiène du matin. « Purifiez-vous le corps, aimait-il à répéter à tort et à travers, avant que de vouloir prétendre au sauvetage de votre âme ». Ce genre de phrase, de la part du fils du chiffonnier du coin, surprenait les voisins, mais lui attirait un auditoire chaque jour encore plus nombreux.
Après s’être complètement redressé sur ses deux jambes, il s’étira, ressentit une violente douleur aux reins et jura « Ces rhumatismes me crucifient ! Je n’ai pas trente ans, et me voilà déjà plus perclus que le pauvre Job. C’est à croire que je porte le poids du monde sur mon dos… ».
D’un pas cependant ferme, il traversa la pièce et s’en fut donner un violent coup de pieds dans les côtes de celui qui dormait, affalé comme un hippopotame sur le grabat d’à côté. « Debout, gros tas ! Tu vas nous faire rater le bus de six-heures trente… ».
Le gros tas s’appelait Simon Kaplan. Il ne possédait que deux qualités. La première, de pouvoir casser la gueule à qui il voulait. L’autre, d’exceller à la pêche au lancer, à la moche, à la traîne et à l’épervier. C’est pourquoi on l’avait surnommé Simon-le-pêcheur.
« Je t’ai déjà dit cent fois, lança Simon en se levant puissamment, de ne pas me shooter comme ça de si bon matin. Tu pourrais, par exemple, me chanter des cantiques au creux de l’oreille, foutre de Dieu !
– Comment tu m’appelles ?
– Excuse-moi, c’est un sobriquet qui me vient machinalement à l’esprit quant je te regarde.
– Si tu crois que je n’ai pas vu à quelle heure tu es rentré hier soir… Tu aurais pu tout aussi bien finir ta nuit de débauché chez la Madeleine. N’essaye pas de mentir, je sais tout.
– Les flics sont venus faire bouclé le clandé vers trois heures… Et puis merde ! je suis pas marié et j’ai pas fait vœu de chasteté que je sache !…
– Il Il faudra qu’on en reparle un de ces jours.
– Mais regarde-toi donc, Rêveur… T’as jamais touché à une femme, hein ? Tu connais pas l’extase alors ?… Quand je pense que je connais des tas de filles qui laisseraient leur mac tomber pour te suivre à genoux… Mais dans quel monde vis-tu donc, Rêveur ?…
– Justement parce que se sont des filles, Pêcheur, leur chair ne m’intéresse pas. Et je t’ai dit un nombre incalculable de fois que la matière est vile…
– À d’autres, Rêveur ! Garde tes prêchi-prêcha pour ceux qui sont dégoûtés de la vie. On ne me la fait pas de cette façon, Rêveur… T’as pas faim, je vais faire à bouffer. J’ai la dent.
Un vieux buffet qu’ils avaient dû ramasser dans une décharge publique (il lui manquait un pied et nombre de tiroirs) finissait son existence dans un coin de la pièce. Vraiment, il ne payait pas de mine et le chiffonnier le plus en dèche n’en aurait pas voulu pour un sou. Mais, chose curieuse, l’antique mobilier regorgeait toujours de la nourriture des plus fraîches, succulentes pour la plupart. Jamais n’y manquaient le pain frais et le vin jeune. Simon avait coutume de dire que leur masure fleurait (un mot qu’il avait dû entendre quelque part), la boulangerie et le chais.
« Faudra me dire comment tu fais, Rêveur. Tu distribues du manger à tout-va chez tous les pègreleux du quartier, et y a toujours de bonne bouffetance dans cette foutue baraque. Faut faire gaffe, Rêveur ; aujourd’hui, la plus merdique des boutiques se munit de tout un appareillage de caméras biscornues. Tu te fais épingler pour un cageot de raisins, tu te fais tabasser par des brutes de vigiles et tu te retrouves en taule comme un pourri. Alors, adios la rue, adios la vie… C’est plus comme avant ; ils rigolent plus les capitalistes ; tu leur subtilises un centime de sous leur matelas de fraîche, et les voilà qui hurlent à l’attentat et font donner l’artillerie lourde.
– La richesse des riches ne leur appartient pas.
– Je te trouve bizarre ces temps-ci. Tu serais pas devenu communiste par hasard ? Ecoute, Rêveur, nous on te suit où tu veux, ok ? Mais faudra pas nous mettre de la politique dans la sauce, ok ? D’abord moi, j’y comprends pas une raque, et puis ça a jamais été not’blaud.
– Tout s’apprend, Pêcheur, tout s’apprend… Tu verras que c’est pas plus difficile d’étouffer un gigot chez Chine… Fais-moi confiance, nous aurons des alliés. Eux s’y connaissent, ça fait des siècles qu’ils baignent dedans.
– Nous avions convenu qu’il te fallait pas recruter sans rien dire. On a toujours fait comme ça. T’es chef ok ; mais aussi on a son mot à dire quand il s’agit d’admettre un nouveau dans la bande.
– Les temps changent, Simon, les temps changent…
– T’es un mystère, Rêveur, foutre de Dieu t’es le mystère fait homme.
L’autobus qui les emmenait traversait la ville, faubourgs sud, périphérie, centre et terminus La Croix. Tout le monde y connaissait Jesu-Christiu. Les femmes, avec qui il adorait bavarder, découvraient toutes après son passage, un petit quelque chose dans leur cabas. Du poisson surtout, car il ne mangeait pas de viande, au grand dam de Simon, son plus proche compagnon, qui, lui, de manière assez paradoxale, exécrait les fruits de mer. Les enfants. Ils leur demandait des nouvelles de l’école ; et si les notes étaient bonnes (ce qui étaient rare), hop ! apparaissait dans sa main une pièce qu’il glissait dans la poche de l’élève, pour ses friandises. L’opinion des hommes était plus partagée à son égard. Les uns le prenaient carrément pour un escroc qui vivait aux crochets de tout le monde en entretenant une bande de petits voyous qu’il utilisait pour accomplir ses petites affaires. Les autres faisaient courir le bruit qu’il s’agissait d’un personnage occulte, doté de pouvoirs incommensurables. Le restant demeurait sans avis, en attendant pour voir.
Pendant ce temps, le Rêveur regardait l’air absent la ville défiler devant lui : ses immeubles en perpétuel état d’élévation et de démolition, ses avenues et rues excavées à longueur d’année, la foule de ses passants bigarrés, sans âme, éperdus, ses commerces prétentieux où les gens s’engouffrent comme dans des temples, cette frénésie de bâtir sur du sable encore plus loin, encore plus haut, lui rappelaient une ville lointaine dont son père lui parlait souvent au temps de son enfance, et dont le nom résonnait encore dans son esprit en termes de fer, d’acier, de béton, d’armatures métalliques et de feu, Babylone.
Mais ses yeux (qui, paraît-il, fascinaient tant les femmes), voyaient autre chose, tandis que le bus remontait le boulevard en grondant : la douce ondulation des collines verdoyantes où paissent de paisibles troupeaux dont le pis des femelles regorge de lait, des immenses vergers dont les grappes, épaisses comme des seins de femme mûre, doraient sous la braise attiédie du soleil, les poissons dans la mer, les oiseaux dans le ciel…
« Rêveur, nous sommes arrivés. »
Comme Simon et lui étaient montés par la porte arrière, Jesu-Christiu alla payer ses deux places au chauffeur du car, un certain Elie Osée. Celui-ci, en même temps que les tickets de contrôle, lui remit discrètement dans la main un petit morceau de papier plié.
Jesu-Christiu prit connaissance du contenu en descendant les deux marches d’accès au véhicule. Ayant mis pied à terre, il se retourna pour questionner Elis Osée :
« C’est grave ? ».
Mais les portes pneumatiques à fermeture automatique s’étaient déjà refermées.
Vincent Placoly
***