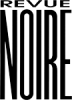Dambudzo Marechera, né en 1952 dans un township de la Rhodésie (actuel Zimbabwe), meurt du sida à l’âge de 35 ans à Harare en 1987. Écrivain et poète, il a été un moment de fulgurance éphémère dans la littérature de langue anglaise. Bouillonnant de révolte et brillant étudiant, il se fait expulser de l'université de l'ex-Rhodésie du Sud en 1972 ; admis à Oxford, il n'y connaîtra pas non plus la sérénité, chassé de l'université anglaise pour ses "provocations". Il retournera dans son pays en 1982. Marechera entre en littérature comme une météorite. À 27 ans, il reçoit le prestigieux Guardian Fiction Price en 1979 avec son recueil de nouvelles 'The House of Hunger’ 1978 ('La maison de la faim', Édition Dapper 1999).
Autres textes publiés : 'Black Sunlight' 1980 ('Soleil noir', Édition Vents d’Ailleurs 2012) ; 'Mindblast or The Definitive Buddy'1984 ; 'The Black Insider', et 'Cemetery of Mind' 1992 ; 'Scrapiron Blues' 1994
***
Le bruit lent de ses pas
[publié dans RN 05 en juin 1992, texte original en anglais-Zimbabwe traduit par Christopher Bowyer-Johns]
Mais si un jour je m'assieds
Tranquillement à cet angle, attentif,
Le bruit lent de ses pas pourrait passer par ici.
J.D.C. Pellow
J'ai rêvé cette nuit que le chirurgien prussien Johann Friedrich Dieffenbach avait décidé que je bégayais parce que ma langue était trop grande ; et qu'il a taillé mon gros organe en enlevant des morceaux au bout et sur les côtés. Ma mère m'a réveillé pour me dire que mon père avait été renversé par une voiture passant à grande vitesse au rond point ; je suis allé à la morgue pour le voir, ils avaient recousu la tête au tronc et les yeux étaient ouverts. Je les ai refermés mais ils ne voulaient pas rester fermés, nous l'avons enterré plus tard les yeux regardant fixement toujours vers le haut.
Il pleuvait au moment où nous l'avons enterré.
Il pleuvait au moment où je me suis réveillé le cherchant. Sa pipe posée où elle était depuis toujours, sur la cheminée. Au moment où je l'ai regardée la pluie s’est mise à tomber à torrents faisant crépiter la tôle ondulée du toit des souvenirs que je gardais de lui. Ses livres reliés cuir étaient debout, complètement immobiles sur la bibliothèque. Un parmi ceux-ci s'appelait Un Manuel du Bégaiement par Oliver Bloodstein. Il y avait aussi une tablette cunéiforme - une réplique de l'original - sur laquelle était inscrite depuis plusieurs siècles avant Jésus Christ une prière fervente pour libérer de l'angoisse du bégaiement. Il m'avait dit que Moïse, Démosthène et Aristote avaient également des problèmes d’élocution ; que le Prince Battus, sur les conseils d’un oracle, s'est guéri du bégaiement en faisant la conquête de l’Afrique du Nord ; que Démosthène s'est appris à parler sans se bloquer en criant plus fort que le déferlement de la mer la bouche pleine de cailloux.
Il pleuvait toujours au moment où je me suis allongé et j'ai fermé les yeux, je pouvais le voir étendu dans la fosse détrempée essayant de bouger ses mandibules. Au moment où je me suis réveillé je pouvais le sentir à l'intérieur de moi ; il s'efforçait à parler, mais je n'y arrivais pas. Aristote murmurait des choses qui disaient que ma langue était anormalement épaisse et dure. Hippocrate a ensuite ouvert de force ma bouche et a appliqué des substances visqueuses sur ma langue pour drainer le fluide noir. Celsus hocha la tête et dit : “La langue a seulement besoin d'un bon gargarisme et d’un massage”. Mais Galien, qui ne voulait pas être écarté, a dit que ma langue était simplement trop froide et humide. Puis Francis Bacon a suggéré un verre de vin chaud.
Comme je descendais à la taverne j'ai vu une longue file de véhicules transportant des troupes rangées devant les portes du faubourg. Tous les soldats étaient blancs. L'un d'entre eux est descendu, il m'a donné des coups avec son fusil en demandant à voir mes papiers. Je n'avais que ma carte d'étudiant. Il l'examina pendant tellement longtemps que je me demandai ce qu'il pouvait lui reprocher.
– Pourquoi tu transpires comme ça ? m'a-t-il demandé.
J'ai sorti un morceau de papier et un crayon, j'ai écrit quelque chose, je le lui ai montré.
– Muet, hein ?
J'ai fait un signe de tête.
– Et tu me prends pour un idiot, hein ?
J'ai hoché la tête. Mais avant que je ne puisse finir de hocher la tête, sa main s’est dressée en un éclair et m'a frappé à la mâchoire. J'ai levé la main pour essuyer le sang, mais il l'a arrêtée et m'a frappé à nouveau. Mes fausses dents se sont cassées et je craignais d’avaler les fragments pointus. Je les ai crachées sans lever la main à ma bouche.
– Fausses dents aussi, hein ?
Les yeux me cuisaient. Je ne le voyais pas clairement. Mais j'ai fait oui de la tête.
– Fausse identité aussi, hein ?
J'avais le désir accablant de bouger les mâchoires et de forcer ma langue à répéter ce que ma carte d'étudiant lui avait dit. Mais je n'ai réussi qu'à croasser des sons inintelligibles. J'indiquais mon morceau de papier et le crayon qui étaient tombés par terre.
Il a acquiescé d’un signe de tête.
Mais au moment où je me suis baissé pour les ramasser, il a tout d'un coup levé le genou et a failli me briser le cou.
– Tu cherchais une pierre, n'est-ce pas, hein ?
J'ai hoché la tête et elle me faisait tellement mal que je ne pouvais plus m'arrêter de hocher la tête. J'ai entendu le bruit de pas courant derrière moi ; les voix de ma mère et de ma sœur. Il y a eu la détonation d'une arme à feu. Ma mère, frappée en pleine course, son corps rigidifié par l'air âcre, avait les yeux fixement pointés devant elle. Une seconde plus tard quelque chose s'est cassé à l'intérieur d'elle, elle s'est écroulée. La main tendue de ma soeur, se levant pour me toucher le visage, s’est envolée vers sa bouche ouverte et je la voyais forcer ses cordes vocales pour hurler à travers ma bouche.
Ma mère est morte dans l'ambulance.
Le soleil hurlait silencieux au moment où je l'enterrais. Son éclat humide était entourée d'anneaux chauds et froids. Ma sœur et moi nous avons fait les quatre miles à pied pour rentrer, passant devant l'hôpital Réservé aux Africains, l’hôpital Réservé aux Européens, le camp de la Police Sud-Africaine Britannique, le Bureau de Poste, la gare, nous avons traversé la ceinture verte large d'un mile et sommes entrés dans le quartier noir.
La pièce était si calme que je ressentais son effort pour bouger sa langue et ses mandibules, essayant de me parler. Je regardais fixement les poutres en bois du toit. J'entendais ma sœur arpenter sa chambre à côté. Je la ressentais très fort à l'intérieur de moi. Ma chambre ne contenait rien d'autre qu'un lit en fer, mon bureau, mes livres et les toiles sur lesquelles je m'efforçais depuis si longtemps de peindre les émotions de mes voix intérieures silencieuses mais désespérées. Je retins mes larmes et sentis ma sœur si fortement en moi que je ne pouvais plus le supporter. Mais la porte s'est généreusement ouverte et ils sont entrés en la tenant par la main. Elle était habillée d’un blanc pur. Une lumière bleue pâle émanait d'elle. Ses pieds menus portaient des sandales de cuir d’un blanc luisant. Mais le magnétisme de sa figure sans chair, des deux orbites vides des yeux, des dents pointues grimaçantes (une de ses dents était légèrement ébréchée), des pommettes saillantes, du nez cruellement absent - emprisonna mon regard jusqu'à ce que mes yeux fatigués, me semblait-il, aient été engloutis dans son immobilité rigide.
Il était vêtu de noir. Sa main à elle sans chair restait immobile dans ses doigts à lui sans chair. On ne lui avait pas bien recousu la tête, elle s'inclinait d'un côté, instable, comme si elle allait tomber à tout moment. Son crâne était fendu par une fracture déchiquetée du milieu du front jusqu'à l'extrémité de la mâchoire inférieure ; il semblait que le crâne, grossièrement ressoudé, pouvait se désintégrer à tout moment.
La douleur dans mes yeux était insupportable. J'ai cligné des paupières. Quand j'ai réouvert les yeux ils étaient partis. Ma sœur se tenait à leur place. Sa respiration difficile me faisait mal à la poitrine. J'ai tendu la main et je l'ai touchée : elle avait chaud, était vivante et son souffle même était plein de sollicitude douloureuse dans ma voix. Il fallait parler ! Mais avant de pouvoir prononcer un seul mot elle s'est penchée sur moi et m'a embrassé. L'élan chaud du baiser nous plongea dans les bras l'un de l'autre. Dehors, la nuit bruissait sourdement sur le toit, le vent avait redoublé de force contre les fenêtres. Nous entendions au loin les cuivres et les cordes d’une musique militaire éloignée.
Dambudzo Marechera
[in 'The Penguin Book of Southern African Stories', Ed. Stephen Grey, Penguin 1985]
***