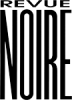La première rencontre
par Simon Njami
Certaines genèses, dès lors que l’on en connaît le développement, plutôt que d’être précises, comme peuvent l’être des actes fondateurs (mais cela ne fonctionne que dans les mythes qui sont passés par le moule de l’idéologie) deviennent au contraire poreuses, volatiles, fantasques.
D’où l’intérêt des les reconstruire à plusieurs mains. Les uns corrigeront les oublis des autres, les autres freineront le romantisme dans lequel, parfois, une aventure humaine avérée peut nous entraîner.
Les genèses deviennent des souvenirs, et à ce titre, s’apparentent plus à un roman personnel qu’à l’Histoire. Mais qu’importe.
Nous ne donnons pas pour tâche de faire œuvre d’historien, mais plutôt de mémorialiste, et, là où la mémoire ferait défaut, pourquoi pas, de romancier. C’est ainsi que dans mon esprit, se déroule l’histoire de Revue Noire : une salle de rédaction de la rue d’Enghein, dans le dixième arrondissement de Paris, un ami, Bruno Tilliette, qui me parle d’un de ses amis, architecte, rencontré dans je ne sais plus quel cadre à Asilah, au Maroc.
C’est une route de terre battue par les vents, une tasse de thé dans le quatorzième arrondissement, plus tard, avec, passant comme une ombre dans la pièce où Jean Loup Pivin et moi achevions de faire connaissance, un Mauricien que plus tard je nommerais amicalement Vijay, et dont les manières languides qui me renvoyaient à la douceur coloniale.
Il y a, encore, devant ce journaliste que j’avais connu adolescent, l’arrogance affichée d’enfants gâtés lorsque nous affirmions, autour d’une interview qui n’en avait ni le ton ni le protocole, que nous avions été réunis par des affinités électives. Il y a les heures interminables passées dans un restaurant à boire et à parler, à concevoir ces délires voluptueux et gais, comme le savoir qui nous affectionnions qui, plus tard, prendraient forme, par l’infaillible magie de l’œil infaillible de Pascal Martin Saint Leon.
Peut-être, dans ce premier chapitre d’une très longue aventure qui dépasse de loin le simple cadre éditorial et productif, vais-je m’attarder un peu plus longuement sur les fondements théoriques, je dis bien théoriques, qui ont cimenté cette aventure. Si j’emploie ici le mot « théorie », c’est à dessein. Nous avons toujours préféré les poètes aux universitaires, les faiseurs, pour reprendre l’expression de Pascale Marthine Tayou, aux ratiocineurs. Certains, qui ne le comprirent que trop tard, nous le reprochèrent. Nous laissions faire. On nous reprochera tant de choses… Notre idée était éminemment simple : tout procède de la forme, et une bonne image vaut mieux que toutes les thèses. Pour raconter une ville, il faut la vivre, non pas avec le souci d’exhaustivité de l’entomologiste, mais avec la profonde légèreté de l’amoureux. De l’être vivant qui se définit non par ses mots, mais dans ses actes. Notre champ d’investigation ? L’Afrique.
De l’Afrique, autant l’avouer d’emblée, nous n’avions qu’une intuition, là où de nombreux autres ne voyaient qu’une négation. Une intuition que je qualifierais de physique. En effet, nous entretenions tous les quatre avec ce continent une relation privilégiée. A la vérité, lorsque je parle du continent, je devrais plutôt parler de quelques pays qui avaient agi sur nous comme le ferait une initiation. Et cette Afrique-là, ces souvenirs et ces sensations-là, ce mouvement perpétuel, ces rires, cette faculté à faire feu de tout bois qui nous avaient enchantés. Pas de romantisme fin dix-neuvième siècle, mais des êtres de chair et une création dont nous ne voyions pas le reflet dans le monde qui nous entourait. Notre mission, appelons ainsi la passion qui nous poussa à des extrémités sur lesquelles je reviens peut-être dans d’autres chapitres, à montrer l’Afrique pour ce qu’elle était. Sans pathos ni discours. Bien sûr, il y avait l’autre Afrique. Celle dont les media du monde entier faisaient leurs choux gras. Nous ne l’ignorions pas. Comment aurions-nous pu. Simplement, nous avions décidé de laisser à d’autres le soin charognard de s’en repaître.
Notre éthique, que l’on me pardonne l’usage d’un mot aussi lourd, était d’une simplicité biblique : il n’est rien qui soit produit par l’homme qui me soit étranger. À partir de là, l’exotisme, le misérabilisme, les lieux communs se trouvèrent d’emblée écartés ? Cette Afrique-là, celle qui nous passionnait n’était pas à inventer, mais à vivre, à découvrir, non pas avec l’arrogance de l’ethnologue, mais avec l’humilité de l’impétrant. Notre dogme fut de n’en pas en avoir, et de suivre ces fameuses intuitions dont le hasard de la vie nous avaient fait les passeurs. L’alchimie était là. Cette aventure n’aurait pu se faire sans cette équipe-là, sans ce dysfonctionnement organique et très précis qui nous a fait voir. L’aventure, il me semble aujourd’hui, commença bien avant nos rencontres. Quelque part dans un dessein que nous étions appelés à concrétiser. Mais l’émotion de voir nos délires parfois éthyliques se transformer en un objet qui allait, et je pèse mes mots, changer la face de ce que l’on appelle l’Art africain contemporain fut unique. C’était en 1991. Le premier numéro de Revue Noire sortait, avec, en couverture, une sculpture d’Ousmane Sow.
***
par Simon Njami
.